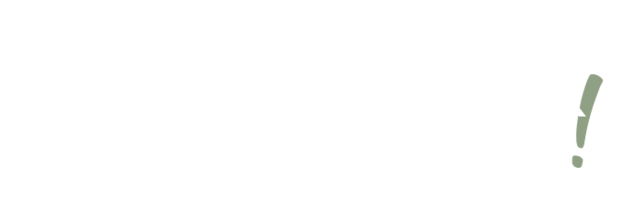Charroux, au fil de l'Histoire...
Depuis la Protohistoire jusqu’à la période contemporaine...
| ...la dense occupation humaine de cette partie du val de Sioule est attestée. Situé à un carrefour (« quadrivium » étymologie latine probable du nom « Charroux »), l’actuel bourg de Charroux a d’abord été un castrum gallo-romain ce dont témoigne encore la structure rectangulaire classique du coeur de ville. Dès le Moyen Age classique (XIe au XIIIe siècle), la cité fortifiée s’est constituée autour du pôle castral plus ancien. Cependant aucune trace de château dans ce que les historiens ont pu retracer de son passé médiéval. Le cœur de la ville est cette place ronde, coeur de la citadelle, dénommée aujourd’hui « Cour de Dames », où se réfugiaient les habitants depuis la fin de l’Empire romain en cas d’attaques en temps de guerre… mais également, par temps calme, pour débattre des affaires communales et entendre les proclamations publiques. Pour protéger cette ville bourgeoise prospère, dotée d’une « charte de franchise » à partir de 1245, deux enceintes de fortifications sont érigées, dont il reste quelques murs et 2 portes (Porte de l’Horloge et Porte d’Orient). Ces dernières donnaient accès, moyennant péage, au cœur de ville après franchissement du fossé de défense et pont-levis (emplacement actuel des jardins). Chacune des enceintes était percée de 4 portes. |
| Au plus fort de son dynamisme commercial, artisanal, culturel, avant le début des guerres de religion, la ville a pu compter entre 1500 et 3000 habitants. On y comptait également 2 églises, 1 chapelle et un couvent comportant dans ses murs son église, sa chapelle et un cloître. A partir de la fin du 15e siècle jusqu’à la Révolution française, Charroux va subir en alternance les ravages des Guerres de religion, ceux des crises économiques, disettes et épidémies perdant entre le tiers et la moitié de sa population. Cet appauvrissement général ne permet plus d’entretenir correctement ses défenses et son patrimoine urbain. Désormais devenu simple village rural, sa population restante connaît la misère, le vandalisme quotidien de certains habitants à l’encontre du patrimoine civil est difficile à réguler par les autorités. Avec la période révolutionnaire, le saccage des édifices religieux fera disparaître les croix, statues, mobilier religieux des églises et du couvent qui seront convertis pour des usages civils avant d’être détruits (incendie, démolition pour vente des pierres et insalubrité faute d’entretien par les propriétaires et exploitants successifs). Les charlois s’opposèrent à la destruction des cloches de l’église Saint Jean-Baptiste en 1793 et partagèrent avec la Commanderie de La Marche les devoirs de sa restauration car l’édifice était partie intégrante du premier mur de fortification et portait dans son aile Sud le système de défense (chemin de ronde, tour de guet ou beffroi). Depuis le milieu du 19e siècle, la population du village a connu un nouveau déclin progressif au fil des transformations structurelles de l’économie rurale (1200 habitants en 1900, 746 en 1921, 357 en 1968, 330 en 1999 et 357 en 2018). |  |
Depuis les années 70, |
En 2008, |
 |